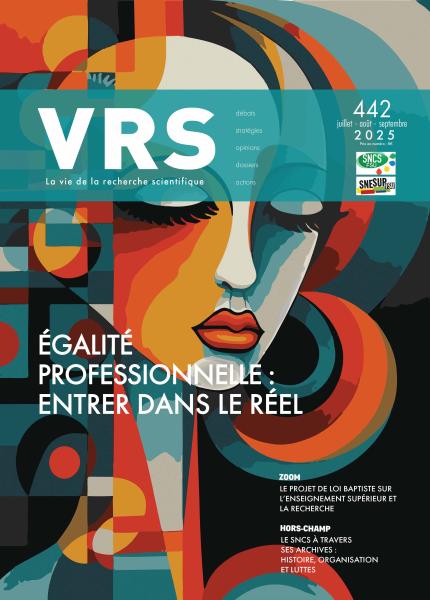édito : La science sur la sellette
Le débat public met en cause les apports de la science d’une manière inacceptable. L’attaque n’est pas nouvelle, elle a pris des formes variées, la prétendue « culture de l’excuse », la supposée suprématie de « la théorie du genre», la soi-disant omniprésence de l’« islamo-gauchisme » ou du « wokisme » à l’université… Elle continue de brouiller le débat public, notamment lorsque les résultats de nombreuses études scientifiques sont délibérément ignorés par les parlementaires lors du vote de la loi Duplomb ou lorsque M. Bernard Arnault dénigre publiquement les travaux et les compétences de l’économiste Gabriel Zucman. Ces procédés sont inacceptables et indignes d’une grande démocratie.
Bernard Arnault cherche à discréditer Gabriel Zucman en le qualifiant de « militant d’extrême gauche ». Alors que c’est un chercheur de renommée mondiale dont les travaux font autorité, voilà sa carrière scientifique réduite à une prise de position politique. Que M. Zucman prenne part au débat public, qu’il mobilise les résultats de ses recherches et l’accumulation de faits qu’il a produits avec d’autres, pour chercher à faire oeuvre utile, au fond, rien de plus normal. Considérer, comme il a été dit, que M. Zucman fait preuve d’une « pseudo compétence universitaire qui elle-même fait largement débat », c’est faire preuve d’une méconnaissance crasse de l’esprit scientifique, et tout particulièrement des sciences sociales dont l’économie relève. Passons sur la première partie de l’épithète (en l’espèce, il n’y a pas de « pseudo compétence »), reprocher de « faire débat » est en soi un argument d’une extrême faiblesse. Dans quelle science les théories, les recueils de données empiriques, les applications, ne font-ils pas l’objet de débats ? Le débat est consubstantiel au travail scientifique, mais il ne consiste pas en un affrontement d’opinions, il est le fait de pairs qui, ayant conçu un langage commun, débattent collégialement et en toute indépendance – à l’écart des puissances d’argent – pour le faire évoluer et l’ajuster aux réalités émergentes.
C’est cette indépendance de la recherche et son corollaire qu’est la liberté académique que le SNCS-FSU et le SNESUP-FSU défendent et promeuvent sans relâche1. La liberté de participer ou non à un colloque en fait partie intégrante. Aucun·e collègue n’a à faire les frais de pressions de quelque nature que ce soit sur ce qui relève d’un choix personnel ou collectif. L’offensive contre la culture scientifique, pilier de la démocratie, ne se limite pas au débat public. La liberté académique se trouve aussi menacée lorsque le Collège de France accepte la « clause de non-dénigrement » de la grande entreprise qui finance une de ses chaires. Un collectif d’étudiant·e·s et d’ancien·ne·s élèves de grandes écoles d’ingénieur·e·s craint pour la liberté de penser et conteste l’« emprise » des entreprises sur leurs établissements, dont il dresse la cartographie2. Rappelons que, selon le Code de l’éducation, le service public de l’enseignement supérieur « doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique » (art. L141-6).
par Emmanuel de Lescure, Secrétaire général
Pour lire la VRS en entier, cliquez ici
________________
1 Liberté académique : résister à la délégitimation du savoir, dossier de la VRS 440, 2025.
2 Collectif Entreprises illégitimes dans l’enseignement supérieur (EIES) avec le soutien de l’Observatoire des multinationales.