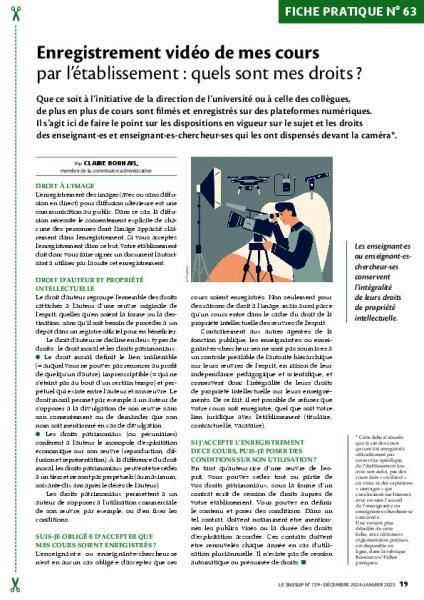Fiche pratique n° 63 - Enregistrement vidéo de mes cours par l'établissement : quels sont mes droits ?
Enregistrement vidéo de mes cours par l’établissement : quels sont mes droits ?
Que ce soit à l’initiative de la direction de l’université où à celles des collègues, de plus en plus de cours sont filmés et enregistrés sur des plateformes numériques. Il s’agit ici de faire le point sur les dispositions en vigueur sur le sujet et les droits des enseignant⋅es et enseignant⋅es-chercheur⋅es (EEC) qui les ont dispensés devant la caméra.
Remarque : Cette fiche n’aborde que le cas des cours qui ont été enregistrés officiellement par un service dédié de l’établissement (ou avec son aide), pas des cours faits « en direct » en visio, ni des captations « sauvages » qui circuleraient sur internet, avec ou sans l’accord de l’E-EC concerné⋅e.
Petit rappel préalable sur le droit à l’image
L'enregistrement des images (avec ou sans diffusion en direct) pour diffusion ultérieure est une communication au public. Dans ce cas, la diffusion nécessite le consentement express de chacune des personnes dont l’image apparaît clairement dans l'enregistrement. Si vous acceptez l’enregistrement dans ce but, votre établissement doit donc vous faire signer un document l’autorisant à utiliser par la suite cet enregistrement.
Petit rappel sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle
Le droit d’auteur regroupe l’ensemble des droits rattachés à l’auteur d’une œuvre originale de l’esprit, quelle qu’en soit la forme ou la destination, sans qu’il soit besoin de procéder à un dépôt dans un registre officiel pour en bénéficier. L’originalité de l’œuvre, définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, est la condition nécessaire et suffisante pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. En France, ces dispositions sont regroupées dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) .
Le droit d’auteur se décline en deux types de droits : le droit moral et les droits patrimoniaux.
• Le droit moral définit le lien inaliénable (= auquel vous ne pouvez pas renoncer au profit de quelqu’un d’autre), imprescriptible (= qui ne s’éteint pas au bout d’un certain temps) et perpétuel qui existe entre l’auteur et son œuvre. Il impose ainsi de respecter la paternité de l’œuvre et le respect de l’intégrité de l’œuvre (interdiction de la modifier). Le droit moral permet par exemple à un auteur de s’opposer à la divulgation de son œuvre sans son consentement ou à demander que son nom soit mentionné en cas de divulgation.
• Les droits patrimoniaux (ou pécuniaires) confèrent à l’auteur le monopole d’exploitation économique sur son œuvre (reproduction, diffusion et représentation). A la différence du droit moral, les droits patrimoniaux peut être cédés à un tiers et ne sont pas perpétuels (au maximum, 70 ans après le décès de l’auteur).
Les droits patrimoniaux permettent à un auteur de s’opposer à l’utilisation commerciale de son œuvre par exemple ou à en fixer les conditions. Ils lui permettent également de toucher des droits d’auteur (sauf si l’auteur les a cédés intégralement à un tiers). Le droit de repentir ou de retrait permet à l’auteur, même en cas de cessions de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé (CPI, art. L. 121-4).
Suis-je obligé⋅e d’accepter que mes cours soient enregistrés ? Non.
Non seulement pour des raisons de droit à l’image, mais aussi parce qu’un cours entre dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle des œuvres de l'esprit.
De manière générale, pour les agent⋅es du service public, la propriété des œuvres de l'esprit produites pour l’accomplissement du service public est transférée à l'autorité administrative dont ils relèvent (articles L. 131-3 à L. 131-3-3 du CPI) 1. Mais il y a une exception à cette règle, en ce qui concerne les « agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, […], à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique » (cf. dernier alinéa de l'article L. 111-1) . C’est le cas de tous⋅tes les enseignant⋅es dans l’enseignement supérieur public, quel que soit le lien juridique avec l’établissement (titulaire, contractuel⋅le, vacataire). En effet l’ensemble des enseignant⋅es « jouiss[a]nt d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement » (article L. 952-2 du code de l’éducation), aucun⋅e n’est soumis⋅es à un contrôle préalable de l'autorité hiérarchique sur l’œuvre de l’esprit que constitue le cours. De ce fait, il est possible de refuser que votre cours soit enregistré.
Si j’accepte l’enregistrement de ce cours, puis-je poser des conditions sur son utilisation ? Oui.
En tant qu’auteur⋅e d’une œuvre de l’esprit, vous pouvez céder tout ou partie de vos droits patrimoniaux, sous la forme d’un contrat écrit de cession de droits auprès de votre établissement. Vous pouvez en définir le contenu et éventuellement la rémunération. Dans un tel contrat, doivent notamment être mentionnés les publics visés ou la durée des droits d’exploitation accordée. Ces contrats doivent être renouvelés chaque année en cas d’utilisation pluriannuelle. Il n’existe pas de cession automatique ou présumée de droits.
1 Note : aucun transfert de ce genre n’existe auprès des employeurs privés (sauf pour la production logicielle). Il est intéressant de remarquer que cette exception assez exorbitante limitant le droit de propriété des fonctionnaires a été construite justement pour permettre justement la diffusion d'émissions destinées à l'enseignement par la voie de la radio ou de la télévision par l’Office français des techniques modernes d'éducation (cf avis du Conseil d'Etat du 21 novembre 1972, n° 309.721, Ofrateme).