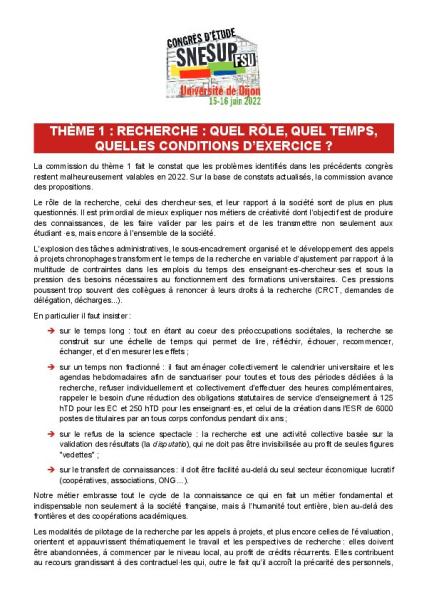THÈME 1 : Recherche : quel rôle, quel temps, quelles conditions d’exercice ?

La commission du thème 1 fait le constat que les problèmes identifiés dans les précédents congrès restent malheureusement valables en 2022. Sur la base de constats actualisés, la commission avance des propositions.
Le rôle de la recherche, celui des chercheur·ses, et leur rapport à la société sont de plus en plus questionnés. Il est primordial de mieux expliquer nos métiers de créativité dont l’objectif est de produire des connaissances, de les faire valider par les pairs et de les transmettre non seulement aux étudiant⋅es, mais encore à l'ensemble de la société.
L’explosion des tâches administratives, le sous-encadrement organisé et le développement des appels à projets chronophages transforment le temps de la recherche en variable d’ajustement par rapport à la multitude de contraintes dans les emplois du temps des enseignant·es-chercheur·ses et sous la pression des besoins nécessaires au fonctionnement des formations universitaires. Ces pressions poussent trop souvent des collègues à renoncer à leurs droits à la recherche (CRCT, demandes de délégation, décharges...).
En particulier il faut insister :
-
sur le temps long : tout en étant au coeur des préoccupations sociétales, la recherche se construit sur une échelle de temps qui permet de lire, réfléchir, échouer, recommencer, échanger, et d’en mesurer les effets ;
-
sur un temps non fractionné : il faut aménager collectivement le calendrier universitaire et les agendas hebdomadaires afin de sanctuariser pour toutes et tous des périodes dédiées à la recherche, refuser individuellement et collectivement d'effectuer des heures complémentaires, rappeler le besoin d'une réduction des obligations statutaires de service d’enseignement à 125 hTD pour les EC et 250 hTD pour les enseignant·es, et celui de la création dans l'ESR de 6000 postes de titulaires par an tous corps confondus pendant dix ans ;
-
sur le refus de la science spectacle : la recherche est une activité collective basée sur la validation des résultats (la disputatio), qui ne doit pas être invisibilisée au profit de seules figures "vedettes" ;
-
sur le transfert de connaissances : il doit être facilité au-delà du seul secteur économique lucratif (coopératives, associations, ONG…).
Notre métier embrasse tout le cycle de la connaissance ce qui en fait un métier fondamental et indispensable non seulement à la société française, mais à l’humanité tout entière, bien au-delà des frontières et des coopérations académiques.
Les modalités de pilotage de la recherche par les appels à projets, et plus encore celles de l’évaluation, orientent et appauvrissent thématiquement le travail et les perspectives de recherche : elles doivent être abandonnées, à commencer par le niveau local, au profit de crédits récurrents. Elles contribuent au recours grandissant à des contractuel·les qui, outre le fait qu’il accroît la précarité des personnels, conduit à une perte de temps et de savoir-faire considérable, avec le renouvellement permanent des équipes.
La société doit relever des défis tant face au changement climatique que devant les modifications de son organisation politique, ou encore en matière d’organisation du travail.
Le rôle de la science est aussi celui de problématiser ces enjeux et de construire des perspectives pour se sortir de l’impasse de la crispation et de l'instrumentalisation des débats. Cette contribution de première importance pour la société ne peut se faire sans la garantie des libertés de développer notre pensée dans toute sa complexité, libertés qui sont aujourd’hui attaquées par des décisions politiques et par les acteurs politiques eux-mêmes.
La recherche est face à un tournant dans son organisation et dans ce que la société en attend, tant dans la diffusion des résultats de la recherche auprès du grand public (« science ouverte ») que de la participation de la société aux travaux de recherche (« science citoyenne »). Comment dans ce contexte s’inscrire dans le temps long nécessaire à la recherche, résister au pilotage de la recherche imposé et préserver les libertés académiques ? Autant de questions urgentes pour reconstruire un enseignement supérieur et une recherche de service public.
Quelques propositions :
-
faire baisser la pression sur les agents, retrouver des conditions de travail vivables pour un travail bien fait : renoncer à la logique managériale, productiviste et utilitariste qui impose un rythme et un mode de fonctionnement incompatibles avec la démarche scientifique fondamentale comme appliquée ;
-
accès à la recherche : faciliter l'association à leur laboratoire des jeunes docteurs sans poste jusqu’à la fin de leur période de qualification. Prévoir des décharges de service de droit pour les enseignant·es second degré affecté·es dans le supérieur (ESAS) inscrit·es en doctorat. Le SNESUP-FSU rappelle sa revendication de transformation des postes d'ESAS docteurs qualifiés en poste de maître ou maîtresse de conférences. Dans l’attente de cette mesure, il propose que des crédits fléchés soient disponibles pour les établissements qui ouvrent des concours de MCF réservés aux ESAS au titre du 2° de l’art 26 du décret statutaire des EC. Enfin le SNESUP réitère l'exigence du respect du droit à la recherche des EC affirmé dans leurs statuts et son mandat d’attribution d’un CRCT tous les 7 ans.
La solution ne réside pas dans des modifications de comportement à la marge. La commission propose d'engager dès cette année plusieurs chantiers :
-
la notion de collégialité : comment réaffirmer l'importance et rendre effective la collégialité contournée dans des dispositifs opaques et par un pilotage vertical de la recherche ? quels contre-pouvoirs ou garanties en cas de dysfonctionnement institutionnel ? ;
-
déontologie, éthique, intégrité scientifique : l'architecture du dispositif actuel, pourtant foisonnante (OFIS, collège de déontologie, référents IS, ...), ne permet pas de retisser des liens de confiance entre les membres de la communauté scientifique et entre la communauté scientifique et la société, ni de donner une réponse satisfaisante à des manquements constatés en particulier au plus haut niveau. Il faut développer des propositions sur des questions telles nomination/constitution et compétences des instances, lien avec les procédures disciplinaires, effectivité des recommandations… ;
-
prise en compte des responsabilités sociales, environnementales, climatiques dans l'évolution des thématiques (et des pratiques) de recherche.
85 % POUR
15 % ABSTENTION